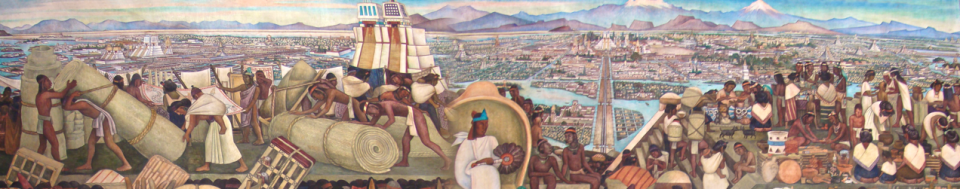• Un ouvrage de Kimberley Theidon sur le conflit armé péruvien qui opposa les forces armées aux guerilleros du Sentier Lumineux de 1980 à 2000; basé sur des témoignages, il s’inscrit dans la continuité du rapport final de la Comisión la Verdad y la Reconciliación remis en Aoüt 2003 au président Alejendro Toledo. Le livre « Entre Prójimos. El conflicto armado interno y la política de la reconciliación en el Perú » publié en 2004, peut être consulté sous format pdf.
• Texte de présentation et PowerPoint de l’intervention de Jacques Guyot et Danièle Téphany au colloque fondateur du Réseau International de Sociologie Clinique, 8-10 avril 2015 à Paris, « Peuples minorisés et cultures de résistance : l’apport d’une sociologie critique et qualitative ».
• Article en français de Virgine Laurent, enseignante chercheuse au département de science politique de l’Université des Andes, Colombie, « Cultures en conflit(s)? Peuples indigènes et politiques publiques en Colombie, vingt ans de réflexions », afin de mieux comprendre les rapports souvent conflictuels entre l’État colombien et les organisations indigènes, notamment suite à la Constitution de 1991 reconnaissant le principe d’une société multiethnique et pluriculturelle :
• Article de Jacques Guyot en anglais paru dans la revue “Journal of Applied Journalism and Media Studies“, volume 4, N°1, 2015, pp. 49/67.
“ Planning policies for language diversity : the weight of national realities in applying international conventions“ Guyot Article
• Note de Danièle Téphany sur les histoires de vie.
“ Notes sur la sociologie clinique et les histoires de vie » Histoires de vie
• Un article en espagnol de Fresia Andrea Amolef Gallardo, doctorante à l’Université autonome de Barcelone, La alteridad en el discurso mediático : los Mapuches y la prensa chilena. Ici : Prensa y Mapuche
L’article donne un éclairage sur le traitement médiatique des revendications Mapuche par la presse nationale chilienne.
• LES MAPUCHE : brève histoire politique, sociale et culturelle. J. Guyot & D. Téphany
Retour sur l’histoire d’une résistance unique à la colonisation:
Par rapport à d’autres peuples indigènes colonisés d’Amérique Latine, la particularité des Mapuche, c’est leur résistance inébranlable aux Espagnols et ce, jusqu’en 1881, date à laquelle le territoire qu’ils occupaient depuis plus de 600 ans avant la colonisation a été annexé à la fois par les Chiliens et les Argentins.1
En Mapudugun, Mapuche signifie gens (che) de la terre (mapu). Ils sont actuellement un peu moins de 1 million au Chili dont les trois quarts vivent dans les grandes villes. Les autres sont concentrés dans leur terre d’origine, l’Araucanie, située au Sud du Rio Bio Bio, où ils représentent jusqu’à 85% des paysans. Ils sont environ 300 000 à vivre en Argentine.
En 1993, la CONADI (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena) a été créée pour favoriser le développement des peuples indigènes; c’est dans ce cadre qu’a été votée la loi indigène 19.253 qui reconnaît officiellement comme peuples « originaires » les Mapuche, mais aussi les communautés moins nombreuses que sont les Aymara, les Atacameña, les Colla, les Quechua, Rapa Nui de l’île de Pâques, les Yámana, les Kawahskar et les Diaguita. Par cette loi, la CONADI est chargée d’administrer les fonds consacrés par exemple à la gestion des terres et eaux appartenant aux indigènes ou encore à l’éducation interculturelle bilingue. L’institution dispose de budgets modestes et reste également très frileuse face aux enjeux économiques, ce qui limite considérablement la portée des actions en faveur des communautés, notamment pour tout ce qui touche à la reconnaissance des droits territoriaux et culturels.
Langue et culture:
La langue qu’ils pratiquent, le Mapudungun (langue de la terre), est en situation de grande fragilité avec un taux de transmission inter générationnelle très bas, hypothéquant les chances d’une véritable renaissance.2 Paradoxalement, c’est souvent dans les villes que se trouvent ceux qui utilisent encore le mieux leur langue dans la vie quotidienne; de même, si le bilinguisme est peu répandu, notamment chez les enfants dont c’est désormais rarement la langue maternelle, le Mapudungun bénéficie d’une forte légitimité et d’un grand prestige tant dans les fêtes et cérémonies rituelles comme le Nguillatun que chez les Longkos (chefs élus par les communautés) lors de leurs prises de parole3.
Les Mapuche pratiquent une religion animiste et les rituels de guérison tout comme la cérémonie annuelle du Nguillatun (liée à la fertilité de la terre) sont conduits par une Machi, généralement une femme qui officie en tant que chamane et guide spirituel de la communauté 4. Son rôle est donc essentiel dans la transmission des valeurs sociales et culturelles.
Le Rewe, utilisé par la Machi lors des cérémonies
Elle peut également jouer un rôle politique important dans les luttes sociales, à l’instar de la jeune Machi Millaray Huichalaf très impliquée dans le conflit opposant la communauté El Roble – Carimallín au projet de construction d’une centrale électrique sur la rivière Pilmaikén et des terres considérées comme sacrées.
Les rapports avec l’État chilien:
Depuis l’annexion de leur territoire par le Chili à la fin du XIX° siècle, les Mapuche ont été spoliés de leurs terres : de 10 millions d’hectares à 500 000 hectares.5 Ils sont également victimes de multiples discriminations et de racisme. D’où leur très forte mobilisation pour défendre la terre contre la déforestation, l’agriculture et l’élevage intensif ou encore la captation des ressources hydriques par des sociétés privées. Cette lutte est contrecarrée par les forces de l’ordre qui usent d’une loi anti terroriste pour arrêter et juger les militants. Ainsi, la légitimité des revendications territoriales (expressément reconnues par la Convention 169 de l’Organisation Internationale du Travail ratifiée par le Chili en 2009 et défendues par de nombreux intellectuels et chercheurs notoires comme José Bengoa6) est traitée par la criminalisation des Mapuche et de leurs sympathisants. Il faut également noter un processus de militarisation des zones où les communautés Mapuche sont fortement mobilisées, avec la présence de véhicules blindés aux intersections de routes et sur les ponts.7 D’un point de vue juridique, les terres spoliées ont ensuite été enregistrées au nom de colons qui les ont souvent eux-mêmes revendues le plus légalement du monde. La question de la terre est donc un enjeu important, à la fois pour tout ce qui touche au type de gestion des ressources naturelles (les Mapuche disent souvent lutter contre la société capitaliste productiviste)8 et ce qui a trait à la cohabitation avec des petits propriétaires terriens, de grandes haciendas et des groupes industriels opérant dans le secteur hydro-électrique, agro-alimentaire ou forestier.
Notes :
1- Pour plus d’information, lire Ana Fernandez-Garay, Parlons Mapuche. La langue des Araucans, Paris : L’Harmattan, 2005.
2- Idem. L’ouvrage présente en détail la langue et la culture Mapuche.
3- Entretien avec Amilcar Forno Sparosvich, Osorno, 28 octobre 2014.
4- Entretien avec la Machi Maria Angelica, San Juan de la Costa, 16 octobre 2014.
5- Alain Devalpo, “Pacífica oposición de los mapuche chilenos“, Historia y lucha del pueblo Mapuche, in Le Monde Diplomatique, Santiago du Chili : Editorial Aún Creemos en los Sueños, 2008, p. 39
6- José Bengoa, Historia del pueblo mapuche, siglo XIX y XX, Santiago, Ediciones Sur, 1991. En tant qu’historien et anthropologue, il intervient régulièrement pour dénoncer l’absence de mesures politiques de la part du gouvernement chilien pour instaurer un véritable dialogue et sortir du processus de criminalisation dont les Mapuche sont l’objet.
7- C’est ce que nous avons pu observer lors d’un déplacement pour visiter la radio communautaire d’Ercilla, le 23 octobre 2014. Voir également Rosamel Millamán Reinao, “La confrontación mapuche contra el sistema neoliberal chileno, Historia y lucha del pueblo Mapuche, op. cit. p. 34.
8- Rosamel Millamán Reinao, idem.
– Article en espagnol sur la formation d’une jeune Shaman Mapuche :
El difícil camino de una niña Machi
– Récit de vie d’une machi collecté par l’anthropologue et historien chilien, José Bengoa: